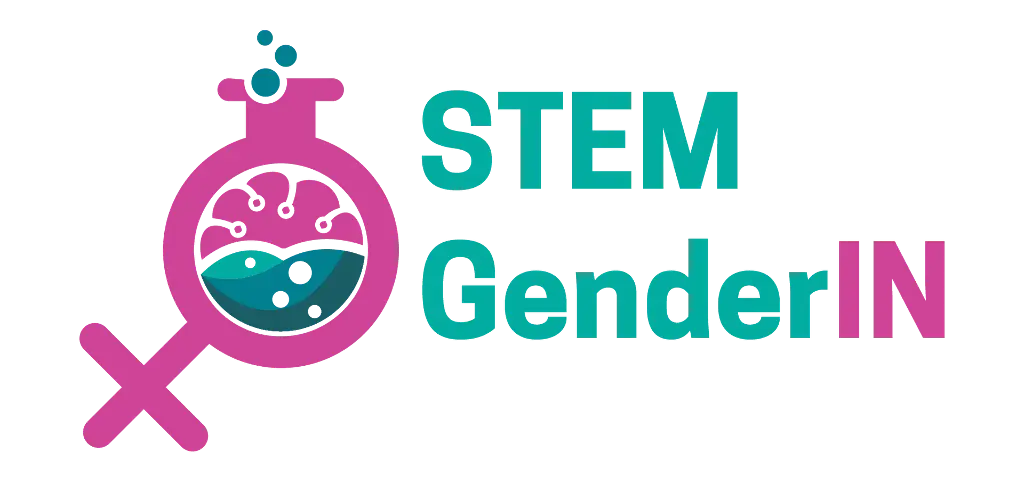Les principales causes de la sous-représentation des filles
Les causes principales de la sous-représentation des filles dans les STEM
La sous-représentation des filles dans les STEM résulte de plusieurs facteurs interconnectés, allant de stéréotypes sociaux profondément enracinés à des pratiques éducatives inadaptées, en passant par des problématiques individuelles de confiance en soi. Comprendre ces causes est essentiel pour pouvoir y répondre efficacement et inverser cette tendance.
Stéréotypes sociétaux
La société joue un rôle central dans la construction des représentations autour des carrières considérées comme « appropriées » ou « naturelles » pour les hommes et les femmes. Dès le plus jeune âge, les filles sont souvent exposées à des messages genrés qui découragent leur intérêt pour les disciplines STEM.
Il existe une croyance de longue date selon laquelle les STEM seraient un domaine « masculin », où les garçons seraient naturellement plus doués en mathématiques et en sciences, tandis que les filles seraient plus aptes aux arts et aux sciences humaines. Ces stéréotypes sont renforcés par les jouets, les médias, et même le langage utilisé par les adultes dans leurs interactions avec les enfants. Par exemple, on valorise souvent les filles en les qualifiant de « créatives » ou « attentionnées », tandis que les garçons sont félicités pour être « intelligents » ou « logiques », ce qui les oriente subtilement vers des trajectoires professionnelles différentes.
Les parents et les enseignant·es, de manière consciente ou non, ont également tendance à s’attendre à ce que les garçons réussissent davantage dans les matières scientifiques. Ces attentes moindres à l’égard des filles peuvent entraîner un manque d’encouragement et moins d’occasions pour elles d’explorer leur intérêt pour les STEM.
Freins dans le système éducatif
Les établissements scolaires et les enseignant·es jouent un rôle crucial dans le renforcement ou la remise en question des stéréotypes de genre. Malheureusement, de nombreuses pratiques éducatives contribuent encore aujourd’hui à la sous-représentation des filles dans les STEM.
Des recherches indiquent que, dans des classes mixtes, les garçons reçoivent plus souvent de l’attention et des retours de la part des enseignant·es dans les matières scientifiques (Copur-Gencturk et al., 2023). Ils sont aussi plus souvent encouragés à expérimenter et à explorer les activités liées aux STEM, tandis que les filles reçoivent moins d’encouragement direct à s’investir dans la résolution de problèmes techniques. Les garçons tendent également à dominer les travaux de groupe et les discussions en classe dans les domaines des mathématiques, des sciences et des technologies, ce qui marginalise davantage les filles.
De plus, les programmes scolaires en STEM sont souvent conçus à partir d’exemples, de problèmes ou d’activités qui résonnent davantage avec les centres d’intérêt des garçons. Par exemple, des problèmes de mathématiques peuvent être formulés autour du sport ou du bâtiment, ce qui peut sembler moins pertinent pour certaines filles. Ce biais subtil rend les matières STEM moins accessibles ou motivantes pour elles, ce qui peut les dissuader de poursuivre dans ces domaines.
La rareté des femmes enseignant·es dans les STEM, en particulier parmi les professeur·es à l’université, est également un facteur important. Lorsque les filles ne voient pas de femmes dans ces rôles académiques, elles peuvent penser que ces domaines « ne sont pas faits pour elles ». La présence de modèles féminins parmi les professeur·es en STEM peut inspirer les filles à se projeter dans ces parcours.
Facteurs personnels et psychologiques
Même lorsque les obstacles sociétaux et éducatifs sont atténués, des facteurs psychologiques individuels continuent d’affecter la participation des filles aux STEM. Ces facteurs sont souvent la conséquence d’influences externes prolongées, qui modèlent la façon dont les filles perçoivent leurs propres compétences et leur potentiel.
Par exemple, les filles sont plus susceptibles de manquer de confiance en leurs capacités à réussir dans les matières STEM, souvent à cause des biais extérieurs. Elles peuvent alors douter de leurs compétences, même lorsqu’elles obtiennent de bons résultats. Cela peut mener au syndrome de l’imposteur, une impression de ne pas être légitime ou compétente dans ces domaines, malgré leurs réussites objectives.
En plus de tous ces facteurs, il existe également des obstacles systémiques qui alimentent la sous-représentation des filles dans les STEM. Le monde professionnel des STEM présente encore de nombreux biais de genre, tant dans le recrutement que dans les possibilités d’évolution de carrière. Les femmes font souvent face à des discriminations lors de l’embauche dans les secteurs STEM dominés par les hommes, et lorsqu’elles sont recrutées, elles rencontrent plus de difficultés à progresser dans leur carrière au même rythme que leurs collègues masculins. Ce manque de perspectives d’évolution peut décourager les jeunes femmes d’envisager une carrière dans les STEM dès le départ.

Il n'y a aucune réaction pour le moment.